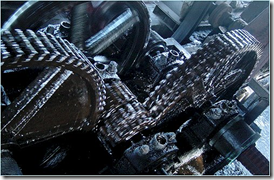Un jour où je n’avais pas envie d’embuer la vitre de mon haleine matinale, je la vis entrer dans le bus. Tel un animal à l’affût, je me dressai droit sur mon siège pour qu’elle me remarquât et elle, petite mais pas trop, visage clair mais malicieux, joua à ne pas m’apercevoir. D'un regard évasif posé vers le fond du couloir, elle continua sa marche goguenarde en se dandinant sur mon œillade suggestive qui suivait son déplacement. Par une souple inclinaison de tête, ses cheveux bruns fournis et bouclés se versèrent sur ses épaules puis, par une enjambée élancée, le mouvement de ses hanches à bascules s’enclencha sur ses arrières généreux. Deux signes qui marquaient à l’évidence sa perception de la situation et le début d’une parade séductrice. Ses pupilles couleur noisette roulaient à l’intérieur de larges et rondes membranes lactescentes pour former deux yeux abusivement armés et donc impossibles à soutenir du regard. Un centième de seconde et ils s’écartèrent pour balayer l’entourage - dont moi exagérément perché sur mon fauteuil - et rapidement ils rejoignirent leur centre d’un mouvement lascif et hautain. Et enfin d’un long entrechat sensuel, elle s’assit trois rangées devant moi, prés de la fenêtre, si bien que je ne voyais plus que sa touffe de cheveux et leur masse grouillante dédoublée dans la vitre.
A cette réflexion étrange se mêlait la mention blanche « securit » certifiant d’une réalité crue les reflets incertains de ses épaules. Elle passa la main dans sa chevelure pour en chasser la moitié côté couloir et découvrit ainsi une nuque laiteuse plantée sur un cou longiligne. Dans le prolongement, « securit » se dessinait maintenant sur son épaule et plantait son T final au centre de ses deux omoplates. La paume de la main posée à plat sur la vitre, il me semblait la toucher, caresser sa toison, faire frissonner sa peau translucide mais cet ersatz ne me renvoyait que la froidure maussade du verre poli. J’avais une envie irraisonnée de fourrager de mes doigts sa jungle capillaire, y glisser mes ongles pour redescendre en prise délicate sur ce bout de chair tendu que formait son cou dans le reflet. J’aurais aimé d’une caresse soutenue faire circuler son sang invisible et rougir sa peau autant que mon visage s’empourprait en plaques saillantes de mes pensées troublées.
Ce matin là, les trois quarts d’heures du trajet scolaire s'évanouirent en quelques secondes. La belle nuée sur le verre descendit du bus sans se retourner, juste avant le dernier arrêt. Tandis qu’elle s’éloignait dans la lueur blafarde, je reposai ma tête sur la vitre et bouche entrouverte, expirai à nouveau un anneau de buée sur la mention « securit ». Mon nez collé à la vitre, j’effaçai les traces de l’inconnue à la peau laiteuse et aux cheveux fugaces.
Texte publié initialement sur les pages du coucou dans le cadre des vases communicants du mois de mai.